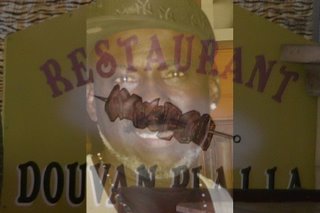La mangrove et la forêt marécageuse sont des systèmes biologiques très productifs, des zones de reproduction et de nurseries ; elles ont, en outre, un rôle de fixation des sédiments continentaux et sont des agents de protection des côtes contre les tempêtes et contre l’érosion côtière. Elles recèlent une faune très riche.
La mangrove et la forêt marécageuse sont des systèmes biologiques très productifs, des zones de reproduction et de nurseries ; elles ont, en outre, un rôle de fixation des sédiments continentaux et sont des agents de protection des côtes contre les tempêtes et contre l’érosion côtière. Elles recèlent une faune très riche.  On y trouve beaucoup d'oiseaux de mer et d'eau douce, sédentaires et migrateurs (frégates, hérons, les aigrettes ou pélicans bruns - grand gosier » en créole - y nichent à l'abri de leurs prédateurs terrestres : ratons laveurs, rats, mangoustes), ainsi que des crustacés, coquillages, mollusques, Bernard-l'ermite et poissons… autant de subsistance pour les populations côtières.
On y trouve beaucoup d'oiseaux de mer et d'eau douce, sédentaires et migrateurs (frégates, hérons, les aigrettes ou pélicans bruns - grand gosier » en créole - y nichent à l'abri de leurs prédateurs terrestres : ratons laveurs, rats, mangoustes), ainsi que des crustacés, coquillages, mollusques, Bernard-l'ermite et poissons… autant de subsistance pour les populations côtières.

 Reconnu comme l’un des écosystèmes les plus importants, le récif corallien est, avec la forêt tropicale, le plus diversifié et le plus complexe de la planète. Les coraux, eux-mêmes, organismes symbiotiques très vulnérables et sensibles à la sédimentation marine et au réchauffement des mers, abritent une biodiversité exceptionnelle. Outre leurs intérêts écologiques, les récifs coralliens, comme les zones humides du littoral, ont une importance sociale et culturelle majeure pour les pays qu’ils bordent (protection naturelle des côtes, réserve de pêche, activités touristiques et de loisirs...)
Reconnu comme l’un des écosystèmes les plus importants, le récif corallien est, avec la forêt tropicale, le plus diversifié et le plus complexe de la planète. Les coraux, eux-mêmes, organismes symbiotiques très vulnérables et sensibles à la sédimentation marine et au réchauffement des mers, abritent une biodiversité exceptionnelle. Outre leurs intérêts écologiques, les récifs coralliens, comme les zones humides du littoral, ont une importance sociale et culturelle majeure pour les pays qu’ils bordent (protection naturelle des côtes, réserve de pêche, activités touristiques et de loisirs...)
Aujourd'hui, ces écosystèmes littoraux se dégradent sur toute la planète : 10 à 15 % des récifs coralliens sont irrémédiablement détruits, une menace certaine pèse sur 40 % d'entre eux, plus de la moitié de la mangrove et des forêts marécageuses des Antilles a disparu durant les 30 dernières années.
Les dégradations sont multiples et diverses, directes ou indirectes : remblais et déblais, aménagement destructeur, érosion côtière qui asphyxie les coraux, pêche intensive et destructrice (utilisation d'explosifs), réchauffement des eaux marines et blanchissement des coraux, rejets urbains, industriels et agricoles...
Leur protection est le combat quotidien de tous les agents commissionnés pour la protection de l’environnement et de tous es acteurs de la société civile.